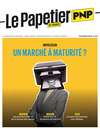©123rf.com/jackf
©123rf.com/jackf En application de la loi Agec, la destruction par incinération ou la mise en décharge des invendus non alimentaires est interdite depuis le 1er janvier 2022. Fabricants, importateurs, distributeurs… Tous les acteurs sont intéressés par cette mesure qui touche aussi bien les produits électroniques que les meubles, les consommables d’impression, les fourn...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous